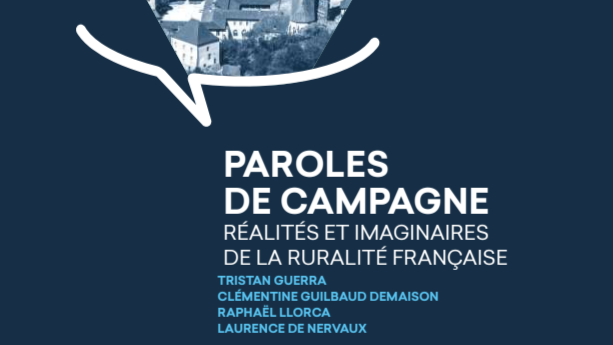
Paroles de campagne : une enquête qui démonte les clichés sur la ruralité et alerte sur le ressentiment de sa population invisibilisée
Un tiers des Français vit à la campagne, selon l’INSEE. Pourtant, la ruralité souffre aujourd’hui d’une invisibilisation et d’une vision déformée de sa réalité dans l’espace politique, médiatique et culturel, constatent trois associations engagées pour la ruralité – Bouge ton Coq, InSite et Rura (ex-Chemins d’avenirs). Ces associations ont décidé, avec le think tank Destin Commun, de donner la parole aux habitants de la ruralité sur leur quotidien et leurs aspirations. L’étude Paroles de Campagne démonte les clichés d’une ruralité figée et passéiste, mais alerte sur l’expérience de relégation des ruraux qui alimente un ressentiment directement corrélé au vote pour le Rassemblement National.
À quelques mois des élections municipales, l’étude révèle un potentiel d’apaisement et de convergence par la valorisation d’un modèle rural qui recèle de nombreux atouts dans sa capacité d’innovation et sa vitalité démocratique.